
Philosophie inclusive
Académie de Créteil
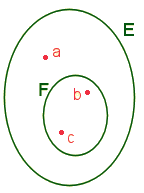

Production : Du réseau ARPANET à Internet
L’origine d’internet vient d’une initiative d’une agence du département américain de la défense à la fin des années 1960, la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, soit Agence pour les projets de recherche avancée de défense) visant à réaliser un réseau de transmission de données (transfert de paquets) à grande distance entre différents centres de recherche sous contrat. Il s’agit de l’ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) qui verra le jour en 1969. Le premier nœud de raccordement relie alors l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et l’Institut de recherche de Stanford, suivis de peu par les universités de Californie à Santa Barbara et de l’Utah puis s’étend progressivement jusqu’à connecter une quarantaine de sites en 1972.
La connexion entre tous les réseaux existants, c’est-à-dire « l’internet » proprement dit, n’est devenue possible qu’avec la définition de normes communes.
En 1970, a été créé un premier protocole de communication, le NCP (Network Communication Protocol). En 1974, les Américains Vint Cerf et Robert Kahn publient un ouvrage dans lequel ils décrivent le protocole TCP/IP qui permet à des réseaux hétérogènes de communiquer entre eux. Dans ce document le terme internet apparaît pour désigner l’interconnexion de plusieurs réseaux. Ce langage commun permet de relier tous les ordinateurs et tous les réseaux existants. En 1983, ARPANET est divisée en deux branches, MILNET étant la partie militaire et ARPANET devenant civil, mais principalement destiné à la communication entre les établissements scientifiques. ARPANET adopte alors officiellement la norme TCP/IP au détriment du NCP. C’est le démarrage d’internet, avec à l’époque environ un millier de postes utilisateurs. La même année, le système de noms de domaines (DNS) est mis au point. Il permet la correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine et plus généralement de trouver une information à partir d’un nom de domaine. La National Science Foundation (NSF) lance, en 1986, le réseau NSFNET en réponse à l’afflux des nouveaux arrivants sur ARPANET qui provoque un phénomène de surcharge. En 1989, les particuliers et les entreprises privées accèdent au réseau. En 1990, ARPANET est intégré au réseau de la NSF qui en finance le développement jusqu’en 1995. En 1992, alors qu’un million de machines sont interconnectées, l’Internet Society (ISOC), association de droit américain à but non lucratif, voit le jour. Elle a pour rôle de promouvoir et de coordonner le développement des réseaux informatiques dans le monde. Elle intègre l’Internet Activities Board (IAB), organisme chargé d’élaborer les normes et standards d’internet.
La création du World Wide Web
Internet s’ouvre véritablement au grand public avec la création, lors du Centre européen pour la recherche nucléaire (CERN), en 1991, du World Wide Web, par Tim Berners-Lee. Il s’agit d’un système d’interface graphique, très ergonomique et très facile d’utilisation, qui permet de passer d’une page ou d’un site à un autre en « cliquant » sur un lien dit « hypertexte ». La navigation sur la « Toile » devient ainsi extrêmement aisée. Le web ouvre donc le réseau à de nouveaux utilisateurs peu familiarisés avec l’informatique. En quelques mois, les sites web se multiplient. Phénomène technique et social de grande ampleur, le World Wide Web a dû se doter, en 1994, d’un consortium pour gérer son évolution afin que ce puissant instrument de publication demeure ouvert, fidèle en ceci à l’esprit d’internet. Le World Wide Web Consortium ou W3C s’est placé sous la responsabilité du Massachussets Institute of Technology (MIT) aux Etats-Unis et de l’Institut national de recherche d’informatique et d’automatique (INRIA) en France.
L’essor d’internet
Depuis lors, internet a connu une expansion planétaire et a permis, grâce à la convergence de l’informatique, de l’audiovisuel et des télécommunications, la multiplication de services de toute nature sur le World Wide Web comme la messagerie électronique, les groupes et forums de discussion, le commerce électronique, la consultation d’informations, la diffusion d’images fixes, de fichiers audio et vidéo…
Et les outils et techniques continuent d’évoluer, avec le développement des réseaux haut débit filaires (ADSL) ou sans fil (WIFI et Bluetooth) ou de l’internet mobile (WAP), ou encore avec les technologies et produits du web 2.0 qui renouvellent les modes d’usages et d’appropriation des services internet par les utilisateurs (RSS, blogs, wikis, outils de partage de photos, de videos, réseaux sociaux tels facebook ou LinkedIn...).
Lire la suite sur La documentation française, dossier
Selon Patrice Flichy, professeur à l’Université de Marne la Vallée (Regards sur l’actualité n°327) :
« Pendant près d’un quart de siècle, de la naissance d’Arpanet (1969) au démarrage du web dans le grand public (1994), internet s’est développé sur ces principes d’échange et de coopération, les grands choix technologiques du réseau ont été fait dans ce sens, de nombreuses expériences d’usages ont également été menées dans ce cadre. Alors que les réseaux de télévision diffusent la même information du centre vers les usagers, que les réseaux de télécommunications, s’ils permettent une communication de point à point, ont une architecture centralisée, internet, au contraire, est un réseau totalement décentralisé où chaque intervenant a le même pouvoir que les autres. […] Les créateurs de cette architecture ont été les premiers à mettre en place des usages expérimentaux axés sur la messagerie, les forums, des bases de données hypertextuelles. Autant de services dans lesquels l’usager est directement impliqué, dans lesquels il peut structurer l’information comme il le souhaite. […] Ainsi, internet n’est pas seulement un nouveau média, mais un nouveau dispositif de traitement de l’information et de communication présent aussi bien dans la vie privée, dans la vie professionnelle que dans la sphère publique. Ces différentes filiations d’internet expliquent que les pouvoirs politiques aient souvent associé cette technique d’information et de communication à un ensemble multiple de projets appelés démocratie électronique, gouvernement électronique, administration électronique, voire gouvernance électronique. […]. Ce qui apparaît incontestable c’est la volonté de faire coopérer les décideurs politiques, l’administration et les citoyens à travers toute une série de dispositifs qui touchent à la préparation de la décision publique, au vote, à la gestion de l’administration et aux services que l’administration fournit aux citoyens. Toutes ces activités peuvent potentiellement être réalisées avec internet. »
La participation
Recueil des résumés des interventions
Le Congrès ASPLF 2021, organisé par la Société française de philosophie, se présente sous deux formes distinctes :
-
Une première partie se déroule depuis le 6 mai dernier, exclusivement en ligne et jusqu’au mercredi 23 juin. Elle réunit, selon un programme défini, les communications présentées dans les diverses sections du Congrès (Ontologie ; Logique et langage ; Art, culture, éducation ; Politique, société, communication ; Travail, technologie, industrie). Pour plus de renseignements, merci de vous connecter à la plateforme https://laparticipation.sciencesconf.org/
-
Une deuxième partie, « présentielle », a lieu à Paris, les vendredi 25 et samedi 26 juin. Elle réunit, sur quatre demi-journées, les conférences et tables rondes plénières.
Participer, c’est d’abord prendre part à quelque chose (action, opération, résultat) ou, à tout le moins, le vouloir. La participation relève du capere, prendre, coopérer à une partie de l’action envisagée (politique, travail, vie privée ou publique). Manière pour les hommes de désirer inscrire leur marque dans le réel, de ne pas se résoudre à l’anonymat muet de l’existence. Manière d’œuvrer activement et à son échelle, au devenir d’une entreprise, quelle qu’en soit la nature. La « démocratie participative » est désormais une revendication récurrente du champ social et politique. Elle atteste ce besoin plus fort, peut-être, dans des sociétés valorisant de plus en plus l’horizontalité du partage consenti, plutôt que la verticalité abrupte du pouvoir ou de la décision.
De plus, les nouvelles technologies appellent et conditionnent ces transformations mentales et ces usages de la communication : réseaux sociaux, Internet, smartphone etc. La participation relève-t-elle alors du leurre, du désir illusoire, du virtuel, du mythe ou de la réalité à inventer et à bâtir ? Le travail à la chaîne d’autrefois serait-il remplacé par la participation en ligne ?
En langage ontologique, la participation signifie dépendre de ce qui n’est pas soi et qui, pourtant, confère être, existence, discours et connaissance. Et cela jusque dans les usages courants de l’expression « participer de » en langue française. Le sensible platonicien participe de l’intelligible, s’il doit recevoir une consistance et une densité de réalité vraie. « Participer de » devient la reconnaissance assumée du lien qui renvoie à la Source de tout ce qui est engendré dans le monde cosmique – par la médiation du démiurge contemplant le Modèle de perfection originaire –, comme dans le topos noêtos où le rapport et la communication des Idées sont référés au Principe premier d’Unité. Le Beau, le Bien, le Juste, le Vrai – autant de vocables pour dire l’Un – se donnent comme le Principe, la Source et la Fin de tout ce qui est, grâce à la participation forte qui le relie à ce qui dépend de lui, ontologiquement et gnoséologiquement, (le multiple, le non être, le devenir, toute forme de négatif ou de mê on).
Une tension n’apparaît-elle pas entre le désir d’expression et le souci de maintenir la rationalité ? Les pratiques contemporaines, dans leurs développements informatiques, suscitent aussi des questions proprement ontologiques, relatives aux langages, aux interactions, aux catégories. Comment la philosophie peut-elle, dans ce registre, contribuer à instituer le dialogue ?
Qu’appelle-t-on « tournant numérique » ?
Introduction
-
Qu’est-ce qu’un livre ?
Chartier Roger, « Qu’est-ce qu’un livre ? Métaphores anciennes, concepts des lumières et réalités numériques », Le français aujourd’hui, 2012/3 (n°178), p. 11-26. DOI : 10.3917/lfa.178.0011.
Qu’est-ce qu’un livre ? La question n’est pas neuve. Kant la formule explicitement en 1798 dans les Principes métaphysiques de la Doctrine du droit
La revue Socio a fait paraître en 2015 un numéro sur le thème Le tournant numérique et après ? dans lequel les contributeurs « cherchent à comprendre comment se déploie la recherche en sciences humaines et sociales sur et avec le numérique, mais aussi, en quelque sorte, en son sein, de l’intérieur, comme partie intégrante d’une nouvelle culture scientifique »
Dana Diminescu, Michel Wieviorka (dir.), Le tournant numérique et après ?, numéro de la revue Socio, 4 avril 2015.
-
« Le réel et le virtuel » - Rencontre avec Anne Cauquelin (30 novembre 2015)
-
« Les réseaux et la communication » - Rencontre avec Pierre Musso (4 décembre 2015)
-
« Le soi et l’identité numérique » - Rencontre avec Bernard Stiegler (3 décembre 2015)
-
Le numérique : une nouvelle ère industrielle ? Bernard Stiegler
-
LES DÉBATS DU NUMÉRIQUE Maryse Carmes et Jean-Max Noyer (dir.)
Le « plissement numérique » du monde est en cours et ce processus affecte les socles anthropologiques de nos sociétés. Le tissage continu, des écritures, des flux et des données, des êtres et des objets, de leurs pratiques, bref l’écologie de ces relations, de ces nouveaux territoires, ne cesse de croître sous ces conditions. Ces transformations sont loin d’être consensuelles et elles mettent en tension les agencements socio-techniques, cognitifs, économiques, environnementaux, culturels, ...
Éditeur : Presses des Mines Collection : Territoires numériques Lieu d’édition : Paris Année d’édition : 2013 Publication sur OpenEdition Books : 22 mai 2014 ISBN : 9782356710550 ISBN électronique : 9782356711038 DOI : 10.4000/books.pressesmines.1654 Nombre de pages : 280 p
"C’est dans la Déclaration d’indépendance du cyberespace de 1996 que John Perry Barlow, poète et militant libertaire, affirme la chose suivante : « nous créons un monde où tous peuvent entrer, sans privilège ni préjugé dicté par la race, le pouvoir économique, la puissance militaire ou le lieu de naissance. Nous créons un monde où chacun, où qu’il se trouve, peut exprimer ses idées, aussi singulières qu’elles puissent être, sans craindre d’être réduit au silence ou à une norme. »
La fracture numérique désigne ainsi les inégalités d’accès aux technologies numériques, c’est-à-dire, tout ce qui touche à l’informatique et aux télécommunications2. Il est alors aussi possible d’entendre l’expression de « fossé numérique », puisque celle de fracture numérique était calquée sur la fameuse « fracture sociale », expression utilisée lors de la campagne électorale de Jacques Chirac en 1995, dénonçant le gouffre séparant une certaine tranche socialement intégrée de la population d’une autre composée d’exclus."
-
Nadia Eghbal, Sur quoi reposent nos infrastructures numériques ? Le travail invisible des faiseurs du web, OpenEdition Press et Framabook, 2017.
Aujourd’hui, la quasi-totalité des logiciels couramment utilisés dépendent du code dit « open source ». Créé et maintenu par des communautés du web, il constitue la clé de voûte de nos infrastructures numériques. Ces fondations sont pourtant fragiles et, si les soutiens viennent à manquer, les conséquences seront lourdes. Mettant au jour les défis auxquels sont confrontées nos infrastructures numériques, l’auteur propose des solutions pour y remédier.
> http://books.openedition.org/oep/1797
Accès intégral web>
Philosophie et internet
-
Jean Louis Poirier, réfléchir avec l’Internet
-
La conférence donnée le 26/01/2017 par Pierre LIVET, Professeur émerite de philosophie de l’Université d’Ex-Marseille, CEPERC UMR 7304, diffusée dans le cadre du Projet P.É.N.I.A. en partenariat avec le Programme Europe, Éducation, École :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10462144/fr/penser-le-numerique-cycle-de-visioconferences-interactives
http://www.coin-philo.net/eee.16-17.docs/eee.16-17_penia_prog.2016.pdf
est désormais disponible en différé : sur le canal Dailymotion :
1. Première partie : Pensées, concepts et contextes
2. Deuxième partie :Pensée de groupe et perspectives trans-groupes -
La conférence de M. Paul MATHIAS, Inspecteur général de philosophie, Doyen du « groupe » Philosophie, sur le thème : PENSER LE NUMÉRIQUE : UNE QUESTION DE PHILOSOPHIE ?, diffusée en visioconférence interactive le 01 décebre 2016 : http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/visio/dans le cadre du Projet P.É.N.I.A. et en partenariat avec le Programme Europe, Éducation, École :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10462144/fr/penser-le-numerique-cycle-de-visioconferences-interactives
http://www.coin-philo.net/eee.16-17.docs/eee.16-17_penia_prog.2016.pdf
est désormais disponible en différé : sur Dailymotion :
I.Penser le numérique : une question philosophique ?
II. Penser le numérique : une question philosophique ? -
Des usages du numérique... et après ?
2018 Paul Mathias -
Le philosophe et le numérique par Paul Mathias
-
Recension Voir selon les écrans, penser selon les écrans de Mauro Carbone Jacopo Bodini (dir.)
Mimesis , 150 pages
« Je vois selon ou avec le tableau plutôt que je ne le vois », écrivait encore Maurice Merleau-Ponty dans son dernier livre, L’Oeil et l’esprit (1960). Livré ainsi dans sa formulation la plus condensée, le leg de cette pensée du penseur incontournable de la perception est aussi le fil conducteur qui a conduit à la publication de Voir selon les écrans, penser selon les écrans, un travail collectif réalisé sous la direction du jeune philosophe Jacopo Bodini et de son maître Mauro Carbone. Partant des réflexions sur la perspective menées à la Renaissance par Alberti, pour aboutir aux écrans numériques, en passant par le cinéma, cet ouvrage démonte certains lieux communs qui donnent lieu à des contresens sur les divers dispositifs de l’image. Tout l’enjeu de cette réflexion collective est de se libérer du regard « égocentré » que la « révolution copernicienne » semble avoir enraciné dans la tradition occidentale, et à partir duquel cristallise une conception inadéquate du rapport du sujet au monde.
Numérique et technique
-
La culture numérique va-t-elle nous faire perdre le fil de l’histoire ? - Mardis des Bernardins
La révolution numérique restera-t-elle dans l’histoire comme un changement de paradigme radical pour l’humanité ?
« Avons-nous passé cet instant singulier où les machines sont devenues si puissantes qu’elles agissent profondément sur le cours de l’histoire humaine, sans retour possible ? »
Gilles Babinet, L’ère numérique, un nouvel âge de l’humanité, Cinq mutations qui vont bouleverser notre vie, Le Passeur, 2014
-
Jean-Hugues Barthélémy, docteur en épistémologie
Simondon aujourd’hui : genèse, histoire et normativité technique conférence en ligne sur la Forge Numérique de la MRSH de l’Université de Caen Normandie
Date : 06/08/2013
Lieu : CCIC Cerisy la Salle Durée : 47:23
Cette conférence a été donnée dans le cadre du colloque intitulé « Gilbert Simondon et l’invention du futur » qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 5 au 15 août 2013, sous la direction de Jean-Hugues BARTHÉLÉMY et Vincent BONTEMS. -
Robert Martine, « Le problème de la philosophie : une solution technique », Le Philosophoire 2/ 2003 (n° 20), p. 139-143
DOI : 10.3917/phoir.020.0139
Outil et instrument
Bruillard Eric. L’ordinateur à l’école : de l’outil à l’instrument . In : Sciences et techniques éducatives, volume 5 n°1, 1998. pp. 63-80.
DOI : https://doi.org/10.3406/stice.1998.1659
www.persee.fr/doc/stice_1265-1338_1998_num_5_1_1659
Rue Descartes n° 55, 2007/1, Philosophies entoilées Corpus
-
L’Internet et ses représentations
par Daniel Parrochia -
Pour une pragmatique des flux par Paul Mathias et Peter Lunenfeld
-
Le principe d’inconnexion web par Geert Lovink et Paul Mathias
-
L’activisme contemporain : défection, expressivisme, expérimentation par Laurence Allard et Olivier Blondeau
-
La démocratisation des savoirs par Mireille Delmas-Marty et Françoise Massit-Folléa
-
Esthétique du flux par Grégory Chatonsky
-
Deléage Jean-Paul, « Le philosophe, la baleine et le reacteur », Ecologie & politique 1/ 2003 (N°27), p. 247-266
DOI : 10.3917/ecopo.027.0247 -
Juanals Brigitte. L’arbre, le labyrinthe et l’océan. Les métaphores du savoir, des Lumières au numérique In : Communication et langages. N°139, 1er trimestre 2004. pp. 101-110.
doi : 10.3406/colan.2004.3260
Numérique et politique
-
Dominique Cardon, Le bazar et les algorithmes : à propos de l’espace public numérique
-
Zask Joëlle, « L’Internet, une invitation à repenser la distinction entre public et privé , Cahiers Sens public 3/ 2008 (n° 7-8), p. 145-158
-
Le Web ou l’utopie d’un espace documentaire
Dominique Boullier, Franck Ghitalla
COSTECH, Université de Technologie de Compiègne,
Centre Pierre Guillaumat – Royallieu rue du docteur Schweitzer, B.P. 60 319 Compiègne CEDEX.
L’exploitation raisonnée du web représente un défi pour nombre d’usagers tant s’y côtoient les modèles de documents mais aussi s’y exercent les difficultés techniques. C’est toute l’activité critique, et plus particulièrement la « lecture », qui se trouve alors remise en question étant donné l’incertitude native de cet espace de navigation.C’est ce qu’aura montré une enquête conduite sur près de deux ans ensuivant dans leur activité une quarantaine d’usagers.
-
WIKIPÉDIA, OBJET SCIENTIFIQUE NON IDENTIFIÉ
Lionel Barbe, Louise Merzeau et Valérie Schafer (dir.)
Éditeur : Presses universitaires de Paris Ouest Collection : Sciences humaines et sociales Lieu d’édition : Nanterre Année d’édition : 2015 Publication sur OpenEdition Books : 23 novembre 2015 ISBN : 9782840162056 ISBN électronique : 9782821862326 DOI : 10.4000/books.pupo.4079 Nombre de pages : 216 p.
-
Première partie de la conférence d’Alexandre MONNIN La philosophie du web 2017 EEE
-
Deuxième partie :L’avenir du numérique 2017 EEE
-
Les enjeux du numérique concernant les ressources documentaires en SHS
2017-A01 Rapport
Ce rapport est la mise en œuvre d’une mesure du Plan d’action en faveur des sciences humaines et sociales du MESR. Il étudie l’évolution des dépenses documentaires en sciences humaines et sociales dans les bibliothèques universitaires entre 2007 et 2015. Il préconise une meilleure visibilité de l’offre, qui serait favorisée par une politique nationale de numérisation et par une mutualisation des services autour de ces ressources documentaires. Il analyse les évolutions des métiers de chercheur en SHS et de bibliothécaire, qui rendent la transformation numérique des ressources documentaires inéluctable et incitent à une ouverture des équipes de recherche à des compétences diversifiées pour développer des projets en humanités numériques.
Lire le rapport : Les enjeux du numérique concernant les ressources documentaires en SHS
-
Arnaud Laborderie, Samuel Szoniecky. Cultiver son jardin numérique : métaphore et dispositifs éditoriaux : Entretien avec Pascal Robert. Interfaces numériques, Lavoisier, 2015, Cultiver le numérique ?, 4 (3), pp.351-368.
Louise Merzeau, « Les paradoxes de la mémoire numérique », InterCDI244, numéro spécial, 2013
Louise Merzeau, Frédéric Louzeau, entretien, Les défis anthropologiques du numérique, Collège des Bernardins, 20 janvier 2016
Antoinette Rouvroy, Bernard Stiegler, « Le régime de vérité numérique », Socio, 4 2015, 113-140
David Guez, http://guez.org/fr/
Qu’appelle-t-on "Humanités numériques" ?
-
Les grandes conférences Del Duca - 19 novembre 2014 - Bibliothèque nationale de France Ce que le numérique fait aux humanités
Par Bruno Latour, sociologue et philosophe des sciences, Prix Holberg 2013.
-
Portail Humanités Numériques - labex TransferS
ATELIER DIGIT_HUM 2015
Paysage et structuration des Humanités numériques à l’ENS
Lundi 28 septembre 2015
Salle des Actes | ENS - 45 rue d’Ulm 75005 Paris
Cet atelier, organisé par le CAPHÉS et le labex TransferS, s’inscrit dans le cadre de journées d’études explorant les projets et les solutions techniques développés en « Digital Humanities » qui mettent en œuvre de nouveaux outils pour l’analyse et la valorisation de corpus. Les chercheurs, enseignants, ingénieurs et techniciens travaillant à l’École normale supérieure de Paris y partagent leur expérience numérique avec des responsables de projets innovants en Humanités numériques.
L’objectif de l’atelier 2015 était de faire se rencontrer et dialoguer les principaux acteurs des Humanités numériques à l’ENS et à l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres (PSL). La matinée était consacrée à la présentation de quelques projets d’actualité à l’ENS. L’après-midi a débuté par une intervention du pôle Humanités Numériques du labex TransferS, suivie d’une présentation des Humanités numériques au sein de PSL et du portail PSL Explore. La journée s’est terminée par une discussion générale sur les Humanités numériques et leur structuration dans la reconfiguration du paysage de l’ENS et de PSL.
Vous trouverez sur ce lien les vidéos de la journée
-
Berra Aurélien,« Pour une histoire des humanités numériques », Critique, 819-820, 2015, p. 613-626, et https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01182509.
-
Cormerais Franck, Le Deuff Olivier, Lakel Amar et Pucheu David,« Les SIC à l’épreuve du digital et des Humanités : des origines, des concepts, des méthodes et des outils », Revue française des sciences de l’information et de la communication, 8, 2016,.
-
Humanités numériques : quelle(s) critique(s) ?
2016-2017 Séminaire DH EHESS
Cette année, le séminaire abordera les humanités numériques sous l’angle de la critique. Si cette question n’est pas nouvelle, elle semble posée de plus en plus fréquemment au cours des dernières années, notamment dans le champ francophone, avec la publication d’un nombre croissant de textes (articles et numéros de revues, en particulier) sur lesquels il est utile de revenir. À travers la lecture et la discussion de ces textes, il s’agira d’explorer non seulement les critiques venues de l’extérieur du champ, mais aussi les approches qui visent à développer, de l’intérieur, la dimension critique que peuvent contenir ces pratiques et méthodes de recherche. Dans quelle mesure ces discours se fondent-ils sur des faits, une histoire, une culture communes ? Quels en sont les enjeux ? Nous les confronterons également aux différentes traditions critiques des sciences humaines et des sciences sociales. Nous proposons ainsi aux participants du séminaire de contribuer à une tâche qui nous paraît maintenant cruciale : expliciter les positions intellectuelles et institutionnelles qui orientent les discours sur les humanités numériques.
OpenEdition Lab
-
Doueihi Milad, « Quelles humanités numériques ? », Critique, 819-820, 2015, p. 704-711
-
Granjon Fabien et Magis Christophe, « Critique et humanités numériques », Variations. Revue internationale de théorie critique, 19, 2016,
-
Guichard Éric, « L’internet et les épistémologies des sciences humaines et sociales », Revue Sciences/Lettres, 2, 2014,
-
Mounier Pierre,« Une “utopie politique” pour les humanités numériques ? », Socio. La nouvelle revue des sciences sociales, 4, 2015, p. 97-112,.
-
Valluy Jérôme, « Collection Humanités numériques plurielles : présentation », 2016,.
-
Pierre-Michel Menger et Simon Paye (dir.), Big data et traçabilité numérique : Les sciences sociales face à la quantification massive des individus , Collège de France, 2017.
Nos traces numériques sont devenues un gisement de connaissances considérable. Comment ces données sont-elles prélevées, stockées, valorisées et vendues ? Les big data sont-elles à notre service, ou font-elles de nous les rouages consentants du capitalisme informationnel et relationnel ? Cet ouvrage collectif explore l’expansion de la traçabilité numérique dans ces deux dimensions, marchande et scientifique.
Accès intégral web
Art et Humanités Numériques
-
Félicie Faizand de Maupeou, « Les bibliothèques d’artistes au prisme des humanités numériques : la bibliothèque de Monet » ; DOI : 10.4000/perspective.6939], Perspective [En ligne], 2 | 2016, mis en ligne le 30 juin 2017
-
Sophie Limare, Annick Girard et Anaïs Guilet, Tous artistes ! Les pratiques (ré)créatives du Web Presses de l’Université de Montréal, 2017.
Sur Internet, qu’est-ce qui différencie une production artistique d’une production amatrice ? Quelles frontières séparent culture populaire et culture légitime ? Trois spécialistes de l’image, de la musique et des écritures web interrogent ici les productions numériques amatrices, dans leurs dimensions sociologique, économique et esthétique.
Accès intégral
-
Des humanités numériques littéraires ? (2017) . Restitution vidéo.
Centre Culturel International de Cerisy
-
Revue Sur Mesure : Ville, corps, numérique
Ido Dweck
20 janvier 2017
Dans la science-fiction la ville « haute » et la ville « basse » illustrent un paradoxe de l’esthétique urbaine contemporaine : la mise à distance de l’expérience du corps au profit d’une rationalité déployée moins dans la forme que dans la norme, faisant oublier un mode de connaissance via les sensations, à l’image d’une ville devenue numérisable. Notre architecte y substitue la ville « interactive ».
-
L’art et la culture à l’ère du numérique : gagnants ou perdants ? avec F-Xavier Bellamy
Usages
-
Marie-France Hazebroucq
Professeure de philosophie LYCÉE LA-BRUYÈRE, VERSAILLES.
Un article qui fait le point sur les sites payants et analyse le contenu de certains sites.
Une offre plus ou moins sérieuse, structurée, intéressée, disséminée, pour les élèves ou les enseignants.
-
De l’espace du document numérique à l’espace d’Internet : projet d’une pensée (im)possible Xavier Sense
L’objectif de cet article est double. Il consiste, en premier lieu, à établir les principales caractéristiques propres aux différents espaces que sont le document numérique et le réseau Internet. D’autre part, à partir d’une déconstruction de certaines tentatives pour représenter Internet, il propose une réflexion sur la pensée afin que celle-ci puisse accueillir et réfléchir un objet fragmentaire et variable.
IN(TER)DISCIPLINARITÉ(S) AU PRISME DES HUMANITÉS NUMÉRIQUES
ACCÉDER AU SITE
Dans le paysage scientifique qui est le nôtre, la cartographie disciplinaire est à la fois le préalable et l’obstacle aux avancées des connaissances. La fragmentation disciplinaire laisse toutefois la place à l’émergence de champs de recherche, apparaissant comme celle d’espaces de dialogues entre les disciplines. Un autre espace participe aujourd’hui au discours sur le brouillage des frontières disciplinaires : les humanités numériques résumant la double tension au cœur des pratiques et des politiques scientifiques actuelles, entre héritage et anticipation d’un part, entre disciplines et domaines de recherche de l’autre. Faut-il alors interroger les disciplines ou investir au sein des humanités numériques les objets ou sujets même d’études pluridisciplinaires ?
-
Toubiana Éric-Pierre, « La guerre est-elle un jeu ? », Topique 1/ 2008 (n° 102), p. 163-180
DOI : 10.3917/top.102.0163
Les bruits de la guerre rendent-ils sourds les humains. Freud fondait sa médication prescrite à la Société Des Nations sur l’importance de la culture comme ultime rempart contre la pulsion guerrière des hommes. L’analyse des avatars de la culture affaiblit l’espérance freudienne. L’architecture des beaux quartiers de la plus belle ville du monde, Paris, dénonce l’omniprésence d’une apologie et d’une nostalgie guerrière. Nous côtoyons ses ombres portées en voulant ignorer cette évidente construction culturelle. Les activités ludiques peuvent, elles aussi, être marquées par la même inscription pulsionnelle : une oscillation entre les mécanismes de liaison contribuant à la constitution de la psyché et les mécanismes de déliaison figurant la destruction de l’homme par l’homme, sont l’œuvre de la pulsion. Le jeu tout comme la guerre sont des représentants-représentations assujettissant l’humain. Du jeu des osselets aux jeux en ligne, la mort marque par son empreinte. De la distraction envisagée naît la destruction désirée. Le Jeu est une métaphore de l’affrontement guerrier. La compulsion répétitive qui signe et influe le jeu comme la guerre. La culture participe à son achèvement...(extrait) -
Arnaud Mercier et Nathalie Pignard-Cheynel (dir.), #info : Commenter et partager l’actualité sur Twitter et Facebook Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2018.
De plus en plus souvent l’information journalistique arrive directement sur les « murs » de nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais aussi LinkedIn ou Snapchat, et bien sûr via des vidéos mises en ligne sur YouTube ou DailyMotion. L’objet de ce livre est d’essayer de comprendre les effets des réseaux socionumériques sur notre rapport aux médias et à l’information.
Disponible en librairie électronique
-
Camille Paloque-Bergès,Qu’est-ce qu’un forum internet ? Une généalogie historique au prisme des cultures savantes numériques, OpenEdition Press, 2018.
Cet ouvrage explore le genre du forum internet, à travers ses formes primitives que sont les listes et groupes de discussions électroniques. Instruments de la science en train d’être discutée, ces outils de communication offrent un éclairage anthropologique, sociologique, politique, voire géopolitique sur la manière dont le champ scientifique envisage et structure sa communication informelle et publique, témoignant ainsi de son rapport à la société.
Accès intégral web
Portail Humanités Numériques - labex TransferS
ATELIER DIGIT_HUM 2016
Les bibliothèques se livrent !
Lundi 10 - Mardi 11 octobre 2016
Salle historique de la bibliothèque - Salle Dussane | ENS - 45 rue d’Ulm 75005 Paris
Cet atelier, organisé par le CAPHÉS et le labex TransferS, s’inscrit dans le cadre de journées d’études explorant les projets et les solutions techniques développés en « Digital Humanities » qui mettent en œuvre de nouveaux outils pour l’analyse et la valorisation de corpus. Les chercheurs, enseignants, ingénieurs et techniciens travaillant à l’École normale supérieure de Paris y partagent leur expérience numérique avec des responsables de projets innovants en Humanités numériques.
Le thème de cet atelier 2016 s’est imposé à partir du constat de la prolifération des bibliothèques numériques et des expositions virtuelles, que ce soit des projets patrimoniaux de bibliothèques généralistes ou d’ équipes de recherches souhaitant mettre en valeur des fonds documentaires de façon innovante. Avec en filigrane la question de savoir comment les bibliothèques se livrent, cette journée s’intéressait à l’articulation entre ces deux types de bibliothèques, et donc de publics, ainsi qu’aux spécificités des différents outils d’exploitation.
Vous trouverez sur ce lien les vidéos de la journée
Bibliographie<
Démocratisation culturelle et numérique
Sous la direction de Damien Malinas
Culture & Musées 24 | Démocratisation culturelle et numérique
ISBN 978-2-330-03885-4
La finalité de la démocratisation de la culture qui avait permis, jusqu’au milieu des années 1990, de mettre en place des objectifs stabilisés proprement culturels, a été remise en cause. Au-delà même de la cohésion sociale, d’autres desseins par la culture, comme le développement économique ou celui des territoires, sont devenus plausibles. Un changement d’échelle s’est opéré. Dans les années 2000, alors que les événements culturels ont constitué un des outils exemplaires de la démocratisation culturelle et que les institutions publiques ont notamment usé de la capacité de rassemblement des expositions et des festivals, la question des publics et de la participation de ces derniers aux grands événements culturels s’est donc posée d’une autre manière, entre individualisation des pratiques et lieux de rassemblement. Les constats sont souvent amers et semblent conduire à une nostalgie où l’écran individuel et le numérique finiraient de parachever ce qui aurait été l’aventure à bout de souffle d’une génération. Le numérique embarqué sur leurs participants interroge à nouveaux frais la réflexivité médiatique de l’événement et celle-là même, identitaire, de ses publics. La culture, l’économie, les territoires voient leur champ investi par le numérique à la fois par la volonté des acteurs et celles des politiques issues de plusieurs ministères. Faut-il pour autant en conclure que le numérique soit une révolution, un instrument sans précédent qui permet de créer des richesses culturelles devenues disponibles pour tous et permettant à tous d’y accéder de fait ?
Fréderic Gimello-Mesplomb, Yves Winkin et Marie-Christine Bordeaux
Passage de témoin [Texte intégral]
Damien Malinas
Introduction [Texte intégral]
Jean-Marc Leveratto, Stéphanie Pourquier-Jacquin et Raphaël Roth
Voir et se voir : le rôle des écrans dans les festivals de musique amplifiée [Texte intégral]
Fréderic Gimello-Mesplomb et Quentin Amalou
Réinvestir le passé du cinéma par le numérique : la photographie de ciné-concert [Texte intégral]
Emmanuel Ethis et Marie-Sylvie Poli
Hopper 2013/Cannes 2013 au prisme des écritures numériques [Texte intégral]
Myriam Dougados, Jean-Louis Fabiani, Julien Gaillard et Yonathan Portilla
Les usages de Twitter au festival de Cannes. Pratiques numériques et construction des opinions esthétiques [Texte intégral]
Guillaume Heuguet
Quand la culture de la discothèque est mise en ligne : Le cas du site Boiler Room [Texte intégral]
Françoise Lempereur
La transmission et la diffusion du patrimoine scientifique immatériel : état des lieux et perspectives [Texte intégral]
Sophie Mariot-Leduc
Mémoire et patrimonialisation des objets : le ca